Le quotidien Le Figaro de mercredi dernier a publié un article qui est une véritable bombe à propos des négociations entre Canal+ et le cinéma. Nul doute que cette information explosive vient du groupe Vivendi qui possède la chaîne et qu’elle a pour but d’avancer un pion dans cette partie d’échec qui doit s’achever d’ici quelques jours. https://www.lefigaro.fr/medias/canal-pourrait-diviser-par-deux-ses-investissements-dans-le-cinema-20211123
Les professionnels du cinéma estiment, ou feignent d’estimer, que c’est du bluff pour les forcer à accepter les aménagements souhaités pas Canal+ dans la chronologie des médias. D’une part avancer la fenêtre de la chaîne à péage de 8 à 3 mois après la sortie en salle. D’autre part retarder la fenêtre des chaînes gratuites, pour fixer celle des plateformes bien au-delà de celle de Canal+.
Mais le projet annoncé présente pour cette dernière un avantage qui est peut-être bien supérieur à celui de gagner cinq mois dans la chronologie des médias : réduire sensiblement les dépenses de la chaîne, puisqu’il s’agirait de transformer Canal + en une chaîne ne diffusant que des films et des séries, l’abonnement pouvant ainsi passer de 40 à 20 € par mois, se rapprochant de celui des plateformes. Une offre qui serait conforme aux accords entre Canal+ avec le cinéma et le CSA qui ne portent que sur les films et les séries.
Et, bien entendu, même si cette réduction entrainait une augmentation du nombre d’abonnés intéressés par le cinéma et les séries, attirés par cette réduction du prix, le chiffre d’affaires de la chaîne pourrait être réduit de près de 50%. Et donc, les investissements obligatoires de la chaîne dans le cinéma, qui sont de 12,5% de ce chiffre d’affaires, seraient réduits de presqu’autant. Soit une perte de 80 millions € par an pour la production cinématographique française.
Par ailleurs Vivendi créerait Canal+ sport, qui reprendrait l’offre de sport de Canal +, avec, là encore, un tarif réduit, plus compétitif pour les abonnés qui ne s’intéressent qu’au sport.
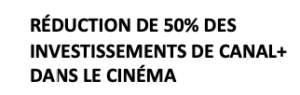
Pour les abonnés qui s’intéressent aux œuvres audiovisuelles et au sport, une offre groupée au même tarif que celui de Canal+ actuel serait proposé. Il faudrait que les abonnés s’adaptent à ces trois options, mais, cela fait longtemps que My Canal est devenu un très efficace opérateur d’un bouquet de chaînes sur internet.
En fait, même en matière de cinéma, pour Canal+, comme dans les salles, les films porteurs sont les films américains, les films français n’intéressant que 35% à 40% du public du cinéma. Or, il est très possible que les deux principaux studios, Disney et Warner, quelle que soit la chronologie des médias, réservent leurs films à leurs plateformes de S-VoD. https://siritz.com/editorial/le-beurre-et-largent-du-beurre/
Certes, le fait que Canal+ ait laissé filtrer ce projet plutôt que de le révéler au dernier moment inclinerait à penser que c’est une arme de pression plutôt qu’une intention arrêtée.
Le succès de la série « Squid Game »
Reste que la vraie bataille des programmes, entre plateformes et chaînes, va se faire sur les séries. Et le succès de la série coréenne « Squid game » sur Netflix démontre que, dans ce domaine, la domination de la production américaine n’est pas aussi éclatante. Il est donc possible que les 80 millions € que Canal+ économiserait sur le cinéma soit en partie ou en totalité investi dans les séries françaises ou étrangères. Que pèsent quelques mois dans la chronologie des médias face à cet enjeu ?
LA RÉMUNÉRATION DE YVAN ATTAL
CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE « LES CHOSES HUMAINES »
C’est le 8ème long métrage réalisé par Yvan Attal qui mène aussi une carrière d’acteur et de scénariste. Son fils est par ailleurs l’un des principaux comédiens et le co-scénariste de ce film. https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvan_Attal
Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.
Les co-producteurs délégués sont Olivier Delbosc (Curiosa films), et Yvan Attal (Les films sous influence) pour un budget de 7,9 millions. Gaumont est distributeur.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Choses_humaines_(film)
c’est l’adaptation d’un roman de Karin Tuil sur une accusation de viol, dont les droits ont été achetés 202 000 €.
Pour la préparation, 43 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 450 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est la troisième rémunération des films sortis depuis le début de l’année. https://siritz.com/financine/barometre-des-realisateurs/
Le scénario a été coécrit avec Yaël Langmann et ils se sont partagés 335 000 €. Si on inclut les droits du livre, c’est très au-dessus de la moyenne des scénarios des films français sortis depuis le début de l’année. Il se situe même dans le top 10. Et ce scénario a un budget total supérieur à la rémunération du réalisateur. https://siritz.com/financine/le-barometre-des-scenarios-au-9-11/
Le film a bénéficié du soutien de la région Ile de France. Il est coproduit par France 2. Canal+, Multithématiques et France 2 ont pré-acheté un passage. Gaumont a donné un minimum garanti pour les droits mondiaux.
Le précédent Film d’Yvan Attal était « Mon chien stupide » qui était sorti le 30 octobre 2019. Il était produit par Same Player et Montauk Films. Studio Canal le distribuait. C’était également l’adaptation d’un roman américain de John Fante.Le scénario avec également été co-écrit avec Yaël Langman et ils s’étaient partagés 338 000 €.
Pour la préparation, 43 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur était de 500 000 €, dont 300 000 € d’à valoir sur droits d’auteur et 200 000 € de salaire de technicien.
Le film avait rassemblé 500 000 spectateurs.
*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 10 ans d’archives.
LES BAROMÈTRES DE MUSIQUE DE FILM
FinanCinéEN € ET EN % DU BUDGET TOTAL
La musique est un élément essentiel de la création cinématographique. Elle l’était déjà du temps du cinéma muet. Les chefs d’œuvres de Charlie Chaplin avaient un accompagnement musical, composé par lui. La musique du « Cuirassé de Potemkine » était composée par Dmitri Chostakovitch.
Certains des plus grands compositeurs mondiaux de musique de film sont français : de Michel Legrand à Maurice Jarre en passant par Alexande Desplat, George Delerue ou Francis Lay. Et plusieurs d’entre eux ont été choisis pour composer la musique de chefs d’œuvre d’Hollywood. Aux Etats-Unis la musique est d’ailleurs considérée comme déterminante pour renforcer la mise en scène et créer l’émotion. Elle représente au minimum 2% du budget d’un film alors qu’en France, pour la majorité des films, le budget est bien inférieur.
Nous publions ici deux baromètres de la musique des films français sortis depuis le début de l’année : en € et en pourcentage du budgte total.
Le budget musical, qui est présenté dans les budgets prévisionnels sous la rubrique « droits musicaux » comprend principalement la rémunération du compositeur ou l’achat de droits de musiques existantes, mais aussi l’interprétation et l’orchestration et même parfois l’enregistrement. Nos baromètres incluent les films de fiction, d’animation et les documentaires.
Le budget de musique de films le plus important est celui de « Aline », réalisé par Valérie Lemercier, une transposition de la vie de Céline Dion. Il est de 960 000 € et représente 4,29% du budget du film, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Il y a évidemment beaucoup d’achats de droits. Les responsables de ce budget sont Rémy Galichel et Laurent Marimbert. https://siritz.com/cinescoop/la-remuneration-de-valerie-lemercier/
Le film qui arrive en seconde position est « Annette », réalisé par Léos Carax. Lui aussi tourne autour de la musique. La supervision musicale et la production exécutive est confiée à Pierre-Marie Dru. La musique, représente un budget de 500 000 €, soit 2,7% du budget total du film. https://siritz.com/cinescoop/la-remuneration-de-leos-carax/
Le budget moyen de la musique est de 68 000 € et le budget médian de 50 0000 €.
En pourcentage du budget du film, le budget musical le plus élevé est celui du documentaire « A la vie », réalisé par Aude Pépin. Il suit une sage-femme féministe. Le budget de la musique est de 23 000 €, soit 8,2% d’un budget total de 280 000 €. https://fr.wikipedia.org/wiki/À_la_vie_(film,_2021)
En seconde position on trouve un film de fiction, « Si on chantait », réalisé par Fabrice Maruca, qui est également un film qui tourne autour de la chanson. Le budget de 480 000 € représente 6,93% du budget total. https://fr.wikipedia.org/wiki/Si_on_chantait_(film)
LA VRAIE BATAILLE DES PROGRAMMES
ÉditorialLe quotidien Le Figaro de mercredi dernier a publié un article qui est une véritable bombe à propos des négociations entre Canal+ et le cinéma. Nul doute que cette information explosive vient du groupe Vivendi qui possède la chaîne et qu’elle a pour but d’avancer un pion dans cette partie d’échec qui doit s’achever d’ici quelques jours. https://www.lefigaro.fr/medias/canal-pourrait-diviser-par-deux-ses-investissements-dans-le-cinema-20211123
Les professionnels du cinéma estiment, ou feignent d’estimer, que c’est du bluff pour les forcer à accepter les aménagements souhaités pas Canal+ dans la chronologie des médias. D’une part avancer la fenêtre de la chaîne à péage de 8 à 3 mois après la sortie en salle. D’autre part retarder la fenêtre des chaînes gratuites, pour fixer celle des plateformes bien au-delà de celle de Canal+.
Mais le projet annoncé présente pour cette dernière un avantage qui est peut-être bien supérieur à celui de gagner cinq mois dans la chronologie des médias : réduire sensiblement les dépenses de la chaîne, puisqu’il s’agirait de transformer Canal + en une chaîne ne diffusant que des films et des séries, l’abonnement pouvant ainsi passer de 40 à 20 € par mois, se rapprochant de celui des plateformes. Une offre qui serait conforme aux accords entre Canal+ avec le cinéma et le CSA qui ne portent que sur les films et les séries.
Et, bien entendu, même si cette réduction entrainait une augmentation du nombre d’abonnés intéressés par le cinéma et les séries, attirés par cette réduction du prix, le chiffre d’affaires de la chaîne pourrait être réduit de près de 50%. Et donc, les investissements obligatoires de la chaîne dans le cinéma, qui sont de 12,5% de ce chiffre d’affaires, seraient réduits de presqu’autant. Soit une perte de 80 millions € par an pour la production cinématographique française.
Par ailleurs Vivendi créerait Canal+ sport, qui reprendrait l’offre de sport de Canal +, avec, là encore, un tarif réduit, plus compétitif pour les abonnés qui ne s’intéressent qu’au sport.
Pour les abonnés qui s’intéressent aux œuvres audiovisuelles et au sport, une offre groupée au même tarif que celui de Canal+ actuel serait proposé. Il faudrait que les abonnés s’adaptent à ces trois options, mais, cela fait longtemps que My Canal est devenu un très efficace opérateur d’un bouquet de chaînes sur internet.
En fait, même en matière de cinéma, pour Canal+, comme dans les salles, les films porteurs sont les films américains, les films français n’intéressant que 35% à 40% du public du cinéma. Or, il est très possible que les deux principaux studios, Disney et Warner, quelle que soit la chronologie des médias, réservent leurs films à leurs plateformes de S-VoD. https://siritz.com/editorial/le-beurre-et-largent-du-beurre/
Certes, le fait que Canal+ ait laissé filtrer ce projet plutôt que de le révéler au dernier moment inclinerait à penser que c’est une arme de pression plutôt qu’une intention arrêtée.
Le succès de la série « Squid Game »
Reste que la vraie bataille des programmes, entre plateformes et chaînes, va se faire sur les séries. Et le succès de la série coréenne « Squid game » sur Netflix démontre que, dans ce domaine, la domination de la production américaine n’est pas aussi éclatante. Il est donc possible que les 80 millions € que Canal+ économiserait sur le cinéma soit en partie ou en totalité investi dans les séries françaises ou étrangères. Que pèsent quelques mois dans la chronologie des médias face à cet enjeu ?
LA RÉMUNÉRATION DE AUDREY ESTRUGO
CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE « SUPRÊMES »
Ce biopic musical est son second film. https://fr.wikipedia.org/wiki/Audrey_Estrougo
Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.
Il est produit par Christophe Rossignon (Nord-Ouest Film) pour un budget prévisionnel de 7,8 millions €. Son distributeur est Sony Pictures qui a donné un très important minimum garanti, pour tous les mandats sauf la télévision. Pour « Opération Portugal », ce Studio américain avait déjà donné un minimum garanti proportionnellement très important par rapport au budget. https://siritz.com/financine/le-poids-de-la-distribution-dans-le-financement/ En terme de fréquentation il est en tête des films français sortis cette semaine.
Pour la préparation, 35 jours de tournage et la post-production la rémunération de la réalisatrice est de 108 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est un peu plus que la rémunération médiane des réalisateurs de films français sortis en 2021. https://siritz.com/financine/barometre-des-realisateurs/
Le scénario a été co-écrit avec Marcia Romano et elles se sont partagées 571 000 €. A notre que Marcia Romano est également co-scénariste de « L’Évènement », qui sort cette semaine. https://siritz.com/cinescoop/la-remuneration-de-audrey-diwan/
Le budget musical du film est de 335 000 €.
Auvergne-Rhône-Alpes cinéma est coproducteur tout comme France 2.
Canal+, Multithématiques et France 2 ont préacheté un passage.
Le premier film d’Audrey Estrugo était « La Taularde », sorti le 20 septembre 2016. Il était coproduit par Rouge distribution et Superproduction pour un budget de 2,7 millions €.
Pour la préparation, 26 jours de tournage et la post-production la rémunération de la réalisatrice était de 49 000 €, dont 23 000 € d’à valoir sur droits d’auteur et 26 000 € de salaire de technicien.
Le scénario avait été co-écrit avec Agnès Caffin et elles s’étaient partagées 51 000 €.
Le film avait rassemblé 203 000 spectateurs.
*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 10 ans d’archives.
LA RÉMUNÉRATION D’ÉMANNUELLE BERCOT
CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE « DE SON VIVANT »
C’est le 6ème long métrage de la réalisatrice. https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuelle_Bercot
Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.
Denis Pineau-Valencienne et François Kraus (Les films du kiosque) l’ont produit pour un budget prévisionnel de 6,8 millions €. https://fr.wikipedia.org/wiki/De_son_vivant
Pour la préparation, 43 jours de tournage et la post-production la rémunération de la réalisatrice est de 150 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est plus que la rémunération moyenne des réalisateurs de films français déjà sortis en 2021. https://siritz.com/financine/barometre-des-realisateurs/
Le scénario a été coécrit avec Marcia Romano qui est également coscénariste de « L’Évènement » qui sort cette semaine. Elles se sont partagées 235 000 €. Comme pour 60% des films français le scénario est mieux rémunéré que la réalisatrice. https://siritz.com/financine/le-barometre-des-scenarios-au-9-11/
Le producteur a investi du numéraire en grande partie couvert par son crédit d’impôt.
Le film bénéficie de 550 000 € d’avance sur recettes.
Canal+ est coproducteur en investissant du soutien financier. Ont également investi 5 soficas adossées et 5 soficas non adossées. La région Ilde de France a apporté un soutien.
Canal+ et Multithématiques ont préacheté un passage. France 2 est coproducteur et a préacheté un passage.
Studio Canal est distributeur. Son minimum garanti est inclus dans son investissement producteur.
Le précédent film réalisé par Emmanuelle Bercot était « La fille de Brest » sorti le 23 octobre 2016. Il était produit et distribué par Haut et court. Son budget était de 5,6 millions €. Pour la préparation, 45 jours de tournage et la post-production la rémunération de la réalisatrice était de 150 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien.
C’était une adaptation du roman d’Irène Frachon dont les droits d’adaptation avaient été achetés 234 000 €. Le scénario avait été co-écrit avec Séverine Bosschem et elles s’étaient partagé 218 000 €.
Le film avait rassemblé 410 000 spectateurs.
*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 10 ans d’archives.
LA RÉMUNÉRATION DE AUDREY DIWAN
CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE « L’ÉVÉNEMENT »
Dès son 2ème long métrage cette réalisatrice a décroché le Lion d’or du Festival de deVenise. ,https://fr.wikipedia.org/wiki/Audrey_Diwan
A noter que la même année, Julie Ducourneau a obtenu la palme d’or du Festival de Cannes avec Titane. https://siritz.com/cinescoop/la-remuneration-de-julie-ducournau/: deux films français et deux françaises sur la première marche des deux plus importants festivals.
Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.
Le film a été produit par Édouard Weill (Rectangle productions) pour un budget prévisionnel de 4,3millions € et il est distribué par Wild bunch.
Pour la préparation, 32 jours de tournage et la post-production la rémunération de la réalisatrice est de 100 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est qui valent à la rémunération médiane des réalisateurs de films français sortis depuis le début de l’année. https://siritz.com/financine/barometre-des-realisateurs/
Elle a en outre reçu 101 000 € pour le sujet. Le scénario a été coécrit avec Marcia Romano qui a reçu 73 000 €.
Le film a bénéficié de 550 000 € d’avance sur recette.
L’investissement en numéraire du producteur est en grande partie couvert par son crédit d’impôt et ses imprévus. Il a mis une petite partie de son salaire et de ses frais généraux en participation.
France 3 est également coproducteur ainsi que 2 soficas dont une sofica adossée à Rectangle productons. Les Régions Ile de France et Aquitaine ont apporté un soutien.
Canal+, Mutithématiques et France 3 ont effectué un préachat.
Wild Bunch a donné un minimum garanti pour les mandats salle et vidéo et un autre pour le mandat international.
Le premier film de la réalisatrice était « Mais vous êtes fou », sorti le 24 avril 2018. Le producteur et le distributeur étaient les mêmes et son budget était de 3,6 millions €.
Pour la préparation, 35 jours de tournage et la post-production la rémunération de la réalisateur est de 70 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. S’y ajoutait 40 000 € pour le sujet. Le scénario avait déjà été coécrit avec Maria romano qui avait reçu 45 000 €.
Le film avait rassemblé 107 000 spectateur
*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 10 ans d’archives.
LA RÉMUNÉRATION DE VINCENT CARDONA
CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE « LES MAGNÉTIQUES »
LA RÉMUNÉRATION DE FRÉDÉRIC FORESTIER
CinéscoopPOUR LA RÉALISATION DE « LES BODIN’S EN THAÏLANDE »
Cette comédie est seconde position des démarrages des films français en 2021 avec, selon Film source, dès le premier week-end, sur 488 copies, 473 000 entrées. Il se situe juste derrière « Aline » qui avait atteint 478 000 spectateurs. C’est le 8ème long métrage du réalisateur. https://fr.wikipedia.org/wiki/Frédéric_Forestier
Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.
Il est produit par Claude Cyndeki (Cheyenne Studio) pour un budget de 6,9 millions € et distribué par SND qui est également coproducteur.
Pour la préparation, 37 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 90 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est moins que la rémunération médiane des réalisateurs de films français déjà sortis en 2021. https://siritz.com/financine/barometre-des-realisateurs/
Le scénario a été coécrit avec Vincent Dubois, Jean-François Fraiscinet qui sont également interprètes principaux du film ainsi que Erich loroc. Ils se sont partagés 695 000 €, ce qui en fait un des scénarios les mieux rémunérés parmi les films français. https://siritz.com/financine/le-barometre-des-scenarios-au-9-11/
Le producteur a investi un numéraire élevé, en partie couvert par son crédit d’impôt et mis en participation une partie de son salaire. Il a mis tous ses frais généraux en participation.
M6 est également coproducteur et a préacheté un passage ainsi que W9. SND a donné des minima garantis pour chacun de ses mandats de distribution : salle, vidéo, tv et vente à l’étranger.
Le précédent film réalisé par Frédéric Forestier était une autre comédie, « Petit poussin », sorti le 28 Juin/2017. Il était produit par Yves Marmion (Films du 24) pour un budget de 9,1 millions € et distribué par UGC.
Pour la préparation, 40 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 200 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien.
Le scénario avait été coécrit avec Romain Protat et chacun avait reçu 46 000 €. Participait également à cette coécriture Charles-Emmanuel Delwart qui avait reçu 67,5.
Le film avait rassemblé 331 000 spectateurs.
*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 10 ans d’archives.
S’ADAPTER À CE QUE VEULENT LES FRANÇAIS
ÉditorialPOUR RENVERSER DES ÉVOLUTIONS INQUIÉTANTES
Un lundi et un mardi avec un Cinéchiffres, qui fournit la fréquentation quotidienne, dans toutes les salles de Paris-Périphérie, un peu supérieur à 40 000 entrées. Je n’ai jamais vu ça depuis la création de cet outil en 2002. Les plus basses eaux étaient au-dessus de 60 000 entrées. Et encore, pas dans des périodes de bonne fréquentation comme novembre.
Pourtant, il y a incontestablement beaucoup de bons films à l’affiche, dans le registre du cinéma commercial comme du cinéma d’auteur.
Globalement, par rapport à 2019, la fréquentation a baissé d’environ 25%. Apparemment ce sont surtout les jeunes qui vont moins au cinéma, mais quand ils y allaient, c’était plutôt pour aller voir des films américains. Or les films américains s’en tirent mieux que les autres. https://www.lesinrocks.com/cinema/box-office-france-aline-en-tete-mais-la-frequentation-est-en-berne-424465-19-11-2021/
D’une manière générale, la fréquentation se répartie entre quelques succès et énormément de déceptions, voire d’échecs.
Parallèlement, selon Médiamétrie, en octobre l’audience de la télévision, qui avait progressé avec le confinement et la pandémie, marque une chute importante par rapport à celle d’octobre 2019. Or, les jeunes ont toujours très peu regardé la télévision. https://www.lefigaro.fr/medias/la-chute-inquietante-du-temps-passe-devant-la-tele-20211116
Visiblement, ces périodes de confinement ont modifié l’approche qu’ont les français de leur temps de loisir, notamment culturel. Mais est-ce l’iphone et les plateformes qui sont la cause de ces évolutions ? Peut-être. Mais ce n’est pas certain.
Car celles-ci sont à rapprocher d’une autre évolution, qui elle est apparemment paradoxale : alors qu’il y a encore énormément de chômeurs, plusieurs secteurs ont du mal à recruter et il y aurait 300 000 emplois non pourvus. Principalement dans des secteurs mal payés et qui ne nécessitent pas une formation poussée, comme la restauration, l’hôtellerie ou le bâtiment. https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/debat-emplois-non-pourvus-pourquoi-certains-postes-n-interessent-ils-pas-les-chomeurs-7900097792
En fait, il y a peut-être un point commun entre ces trois évolutions : pendant le confinement de nombreux français ont réfléchi à ce qu’ils voulaient faire de leur vie et comment l’organiser.
Et ils ont décidé de changer.
La société, et notamment le cinéma et l’audiovisuel, va devoir d’adapter â ce qu’ils recherchent. https://siritz.com/editorial/le-cinema-en-salle-doit-innover/
POUR LA RÉALISATION DE « ORANGES SANGUINES »
CinéscoopLA RÉMUNÉRATION DE JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE
C’est son 2ème long métrage. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_Meurisse
Cinéfinances.info* a fourni les données financières de cet article.
Il a été produit par Édouard Weil (Rectangle Productions) & Marine Bergère ainsi que Romain Daubeach (Mamma Roman) pour un budget prévisionnel de 2 millions €. https://fr.wikipedia.org/wiki/Oranges_sanguines
Pour la préparation, 28 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur est de 60 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien. C’est beaucoup moins que la rémunération médiane des réalisateurs de films français déjà sortis en 2021. https://siritz.com/financine/barometre-des-realisateurs/
Le scénario est coécrit avec Amélie philippe et il a été rémunéré 33 000 €. C’est moins que la rémunération du réalisateur ce qui n’est le cas que de 40% des films français. https://siritz.com/financine/le-barometre-des-scenarios-au-9-11/
Chien de Navarre, la société de Jean-Christophe Meurisse est coproducteur. Le films a bénéficiré d’un soutien des régions Ile de France et Borgogne Franche-Comté.
Il a été acheté par Canal+, Multithématique et C8, mais par aucune des grandes chaînes en clair.
Le distributeur en salle est The Jokers films qui a donné un minimum garanti. Ce distributeur a également un mandat pour la vidéo, la vod, la S-Vod et la tv, mais sans minimum garanti. Best for Ever a le mandat international avec minimum garanti.
Le premier film réalisé par Jean-Christophe Meurisse était « Apnée », sortie le 19 octobre 2015. Il était produit par Emmanuel Chaumet (Ecce films ) pour un budget de 810 000 € et distribué par Shellac distribution.
Pour la préparation, 30 jours de tournage et la post-production la rémunération du réalisateur était de 20 000 €, répartie en part égale entre à valoir sur droits d’auteur et salaire de technicien.
Le film avait atteint 33 000 spectateurs.
*www.Cinefinances.info est un site, accessible par abonnement, destiné aux professionnels du cinéma. Il publie le budget, le plan de financement et la répartition des recettes de tous les films français qui sortent (hors les films « sauvages » qui ne déposent pas leurs contrats au registre public et ne demandent donc pas l’agrément qui leur permettrait d’accéder à l’aide du CNC). Il dispose d’un puissant moteur de recherche multicritères et de 10 ans d’archives.