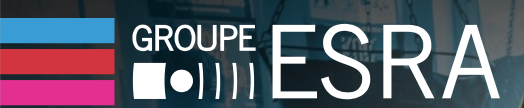UN SCENARISTE MET LES PIEDS DANS LE PLAT
Une bombe à fragmentation. Le scénariste est le créateur principal et reconnu comme telles des séries. Le compte Paroles de scénaristes de Facebook est un de leur mode de communication. Ici, dans une lettre, un scénariste prend la parole pour critiquer l’exception culturelle à la française. Nos lecteurs sont les bienvenus pour aborder ce sujet ou répondre à cette lettre.
IL DENONCE L’ÉCOSYSÈME DE NOTRE CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Alan Smithie*, scénariste hollywoodien mythique, plutôt que de suggérer des pansements couteux et des traitements dispendieux en rajout à un système déjà sous perfusion, a étudié la question avec un regard aussi persan qu’un touriste de Montesquieu.* https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Smithee
Comme Uzbek ou Riga, il a tenu à ce qu’on se pose toutes les vraies questions. Qu’on regarde d’où vient et où va l’argent qui nous manque.
Des comparaisons internationales accablantes
Comparaison avec Israël et les pays scandinaves
Voici les quelques pistes qu’il a dégagé :
– l’audiovisuel français génère 10 fois plus de recettes sur son marché intérieur qu’à l’étranger. Israël ou les pays scandinaves font exactement l’inverse. Mathématique de la démographie ? Certes. Mais dans leurs marchés intérieurs, numériquement faibles, les fictions sont vues par les 2/3 de la population. Et elles récoltent infiniment plus de prix et génèrent plus de remakes ou d’adaptations de leurs formats au-delà de leurs frontières. Le business model les pousse vers l’excellence, là où le nôtre réserve cette exigence à des exceptions qui confirment la règle. Pourtant, n’avons-nous pas les mêmes neurones en France qu’ailleurs ? Sommes-nous à ce point plus médiocres que nos voisins ? La réponse est évidement dans le système productif et éditorial que le monde entier nous envie.
– Ce système loué, révéré, défendu bec et ongles permet en effet de faire des centaines de films par an, là où des pays à bassin de population comparables se limitent à des dizaines, ou moins encore. Cocorico ? Podium ? En quantité, sûrement. En qualité, c’est autre chose. Combien de ces centaines de films sont primés internationalement ? Combien ont une sortie technique, et ne résultent que d’obligations des chaînes d’aligner sur leur étagère des produits qui n’ont même pas été des prototypes, c’est à dire bénéficié de recherche et de vision, et modélisé l’excellence (ce qu’un prototype industriel se doit de faire, et le cinéma, qu’on le veuille ou non reste une industrie) ? Combien de films sortis en salles ne passeraient même pas le test du visionnage pour être diffusés comme téléfilm ? Combien de scénarios ne passent pas une check-list basique de cohérence, d’empathie ou d’addiction ? (un indice: beaucoup – parce qu’on ne leur demande pas d’être bons mais de noircir des pages! Et que ceux qui devraient leur demander n’ont pas la formation nécessaire pour le faire. Comment faire réécrire si on n’a pas appris à lire ?)
On vante une industrie de prototypes (qui n’en sont même pas, en fait) contre les odieuses usines à rêves. Pourtant, de Sophocle à Eugène Sue ou David Fincher, la drogue de synthèse des créateurs est la même : l’émotion, et le but le même : en fourguer au plus grand nombre. Hugo n’avait aucune envie de rester confidentiel, et la plupart d’entre nous non plus. Ce n’est donc pas l’objectif de l’auteur, son travail, mais son organisation, le mode de fabrication, les intermédiaires, les flux d’argent et de décision, et l’architecture financière de son capital qui sont en cause. Aurions-nous donc privilégié le nombre de personnes rémunérés sur la bête plus que la bête elle-même ? En bref, l’emploi primerait-il sur la création ?
Beaucoup de films ne sont pas faits pour être vus mais pour être financés
– nous approchons là d’un vilain secret : beaucoup de films, n’en déplaise à leurs auteurs ou interprètes qui n’en sont pas tous conscients, ne sont pas des films (merci Magritte), mais de simples pompes à pognon. Ben oui. Ils ne sont pas fait pour être vus et appréciés mais pour être financés. Point barre. Le public que nous (les auteurs) visons n’a rien à faire dans cette équation-là. Dur à admettre, mais tellement vrai. Nous ne sommes que les plombiers méprisés de ce syphon rutilant. De simples machines à générer du financement. Et de l’emploi. Et des heures d’intermittence. Le scénario n’a alors rien d’une partition à exécuter, c’est un simple générateur (hélas indispensable, quelle misère !) d’aide, de crédit, un prétexte à Soficas, tax shelter, crédit d’impôt, aides en tous genres (ville, département, région, nation, etc.). Et les plus puissants de nos bailleurs de fonds l’ont compris. Et c’est ainsi que beaucoup de scénaristes victimes sont complices, souvent à l’insu de leur plein gré : ils pérennisent la pompe à fric qui fait des films jetables et des collaborateurs jetés.
– vous vous souvenez de Bowfinger? Dans ce film, le personnage créé par Steve Martin, un producteur aussi génial que désillusionné, explique qu’aucun blockbuster au monde ne coute plus de 2, 184 dollars à produire : tout le reste n’est que combines, publicité et sur-financement. Derrière la galéjade, une vérité au-delà de l’Atlantique comme en deçà. Le ras-le-bol de Maraval sur la sur-inflation des salaires de stars en 2012 ne disait pas toutefois (par pudeur, sans doute) que sa propre marge de producteur (outré comme il se devait de l’être) était indexée sur le budget total du film. Un téléfilm a deux millions ne génère pas beaucoup de bénéfices. Avec la même quantité de travail à peu de chose près au cinéma, le même scénario avec des stars multiplie le budget par 10, et les 15% de marge commencent à en valoir la peine. On commence à comprendre. La qualité n’a pas à être au rendez-vous. Pourquoi écrire pour le public quand ce sont les banques qui vous font vivre ?
C’est là que notre génie national entre en jeu
– Quelle marge si le film n’est pas un succès, me direz-vous ? Comment faire rentrer l’argent quand on ne rentre même pas dans ses frais ! C’est là que notre génie national entre en jeu. La magie de notre exception culturelle ? Celle du budget, automatique. Mais pas que. Certains directeurs de production (qualifiés de magiciens, eux aussi, dont on se repasse les coordonnées comme celles d’une voyante ou d’une maison close) sont de vrais faiseurs de miracles. Avec eux, la marge, c’est le gras du film. On l’enlève ? Surtout pas ! On se la mange ! Ces number crunchers ont d’ailleurs dans leur contrat des pourcentages sur les économies réalisées. Qui sont autant de bénéfices si on ne change pas le budget et le plan de financement du film, ainsi bénéficiaire AVANT son premier tout de manivelle. On budgétise à 100, on finance à 100 ou idéalement plus, on tourne à 75, pour simplifier. Le gras, c’est du bénèf ! Le meilleur scénario se voit alors amputé de scènes de nuit, de véhicules, de figurants, d’enfants, de décors, de costumes, de renforts maquillage/coiffure, de montage, de musique, d’effets spéciaux, de place à la cantine, de caravanes et de voitures ventouses, d’animaux, de cascades ou de musique, bref d’une bonne partie des notes de sa partition : sans ligne de flute, pas besoin de flutiste, le pipo suffit.
Un prestataire de plateaux repas dans le transport aérien m’expliquait qu’une olive pouvait facilement coûter
100 000 euros sur un ravier en plastique (du temps où on prenait l’avion, vous vous souvenez? ), si on la ramenait aux centaines de millions de plateau servis. Une belle scène ? Pour quoi faire si elle est chère, alors qu’un trait de plume ou une touche delete ramène bien plus de sous ? A condition qu’on l’écrive et qu’on la budgétise avant de l’effacer, bien sûr. La création ? Elle est toute entière dans la comptabilité. Reconnue outre-Atlantique qui la pratique aussi. C’est à ce prix que la saga Harry Potter est toujours déficitaire. Mais au moins a-t-elle trouvé son public : le creative accounting de nos voisins vise à en capter les bénéfices en aval, pas à anémier en amont la production value, considérée, elle, comme un produit d’appel dans la plupart des pays étrangers.
Le scénario est d’abord une agence pôle emploi avant d’être une histoire
– Ce secret de polichinelle est partagé jusqu’au CNC, dont les huiles connaissent parfaitement les rouages du système qu’elles lubrifient. Lors d’un séminaire de formation continue sur le financement, il y a quelques années (restons flou) le formateur était gêné d’expliqué à certains pontes de l’institution qu’il fallait apprendre à faire, non un budget, mais 6 ou bien plus pour le même film. Un peu comme pour le Zizi de Pierre Perret, il y en avait pour toutes les bourses. Le sous-gonflé à x pour cent (pour la copro), à y pour cent (pour le fisc), le sur-gonflé à 40% (pour le CNC), celui avec les fausses dépenses (région), etc., et le vrai (ultra-secret et connu d’une poignée d’initiés). Le numéro 3 du CNC d’alors avait éclaté de rire : « tu crois qu’on n’est pas au courant ? Qu’on ignore que votre coût budgétisé d’un HMI loué à la journée, multiplié par X jours au tarif catalogue Transpalux ne sera pas, dûment négocié, divisé par 10 sur la durée du tournage ? ? On le sait parfaitement ! Mais comme on est plafonné à un pourcentage de votre total pour vous aider, on vous demanderait de tricher si vous ne le faisiez pas. Sinon, l’Etat ponctionnerait cet argent non employé pour sa dette ! (ce qu’il fait, d’ailleurs).»
– un autre exemple ? Pourquoi tant de non-auteurs veulent s’approprier un scénario ? On invoquera pêle-mêle la faiblesse des dommages punitifs, la méconnaissance des tribunaux, du processus créatif et le désir refoulé d’enfantement de créateurs stériles qui adoptent de force un projet et imposent leur patronyme au forceps. Foin de cette psychanalyse : mentionne-t-on jamais qu’un scénario payable en droits d’auteur, c’est 6 à 7 fois moins de charges et d’impôts divers qu’un technicien ? Si on épluche de près les contrats des gros films, on verra que le réalisateur préfère très largement minimiser son salaire et sur-enfler le prix du scénario (qu’il l’ait écrit ou pas) de centaines de milliers d’euros : 30% de bonus sur le fisc !
– On continue ? le scénario est d’abord une agence pôle emploi avant d’être une histoire: il va donner ses 507 heures aux dizaines, cinquantaines ou centaines d’intermittents qui travailleront dessus. Il va générer ainsi non seulement le salaire de toute une équipe, mais son chômage tout le reste de l’année. Faites le calcul !
Un scénario rapporte sans jamais être tourné
– poursuivons encore. Même ceux qui ont collaboré à un scénario qui n’a en 20 ans jamais été libre plus de quelques mois, pourront vous assurer qu’un scénario rapporte sans jamais être tourné. Si, vous avez bien lu. C’est une machine à cash ! D’abord, annoncer qu’on veut le produire, contrat à l’appui, génère des lignes d’escompte de banque considérables, à 7 ou 8 chiffres pour le pris d’une option qui n’en a que 4. Avec tableau excel de financement, plan de travail et tout le toutim. Ensuite viennent les « retainer fees », ces sommes qu’une star de l’interprétariat ou de la réalisation réclame pour qu’on puisse le ou la dire attaché(e) au film, ajoutant ainsi poids, crédibilité, re-financement toujours. De quoi payer les salaires, voyages, repas et autres frais généraux d’une boite pendant des années. A perte ? Pas pour tout le monde, puisque les salaires sont versés dans ce purgatoire entre enfer de l’abandon et paradis du tournage (le scénariste, lui, patiente). Une boite tourne extrêmement bien avec 3, 5 ou 10 projets en gestation. Ce sera de les tourner qui coûterait le plus cher. Et probablement le moins rentable.
– Mais les financiers dans tout ça ? Pas de souci, puisque ce n’est que rarement leur argent : les personnes prennent leur dû, les sociétés lissent leurs pertes, en amortissement, sur 3 ans. 3 ans pendant lesquels on s’est payé sur la bête. Les loyers, l’école des enfants, les vacances à la neige ou au soleil ont toujours lieu, que le film marche ou pas. Or, pour qu’il marche, il faudrait du travail, de l’écoute, de la réécriture. Est-ce vraiment nécessaire ? Mieux vaut en prendre un autre et ne pas se casser la tête et la tirelire.
Les plateformes font films et séries pas pour les banques mais pour le public
– bon, la pandémie rebat les cartes et, clouant le public chez lui, oblige à faire des films (et surtout, désormais, des séries) pour lui. Un comble. C’est là où il faut prendre une pierre et lapider les odieuses plateformes qui menacent notre beau système. Bon, reconnaissons que question partage, elles n’ont aucun scrupule à garder tous les droits pour l’éternité, les planètes non encore découvertes, et les moyens de diffusion inconnus à ce jour. C’est, sur le pas si long terme, une terrible menace sur nos rémunérations. Mais force est de reconnaître que les films et les séries, elles ne les font pas pour les banques, pas pour le huitième étage, mais pour le public ; même s’il risque d’être réduit à un algorithme, la recette est efficace et le business model plutôt orienté contenu que contenant. C’est déjà ça. Un objectif où on peut les rejoindre, même si on risque, les contrats susnommés abritent trop souvent les auteurs des retombées financières auxquelles ils pourraient prétendre
– enfin vient la feuille de répartition des droits de diff, qui génère autant de bienfaits que d’effets pervers. Je ne militerai jamais pour sa suppression, mais force est de constater que d’un seul coup, il est aussi difficile de partager son expertise (et donc le savoir-faire global du métier) avec d’autres auteurs quand des sommes y sont attachées, et que les pique assiettes s’invitent souvent à ce festin, sortant de derrière les fagots des contrats de co-auteurs comme une super bouteille (à l’amer à boire) gardée pour la bonne occasion.
Propositions pour rendre le business model plus axé sur le contenu
Tout ça pour vous dire qu’il nous faut, après avoir montré nos cicatrices, travailler sur la prévention. Rendre le business model plus axé sur le contenu, plus vertueux, de force, puisque de gré est manifestement et résolument impensable
– les budgets, oui mais comment les rendre VRAIMENT transparents ?
– donner un intéressement annuel automatique aux créateurs SAUF si contredit par la reddition des comptes annuels, devenue de fait obligatoire
– toute recette n’est pas bénéficiaire : les scénaristes doivent être intéressé(e)s à chaque euro financé que leur contenu génère (accord de coproduction, préachat, financement d’aides publiques, etc.), puisque tout se fait sur leurs scénarios. Il faut en finir avec les RNPP fantômes dont on ne voit pas l’ombre d’un nano-iota après les pléthoriques zéros après la virgule. C’est dès la conception que le scénariste doit être rémunéré.
– repenser l’intermittence autrement ? Y intéresser les scénaristes qui la rendent possible ?
– avoir des dommages punitifs dissuasifs, pour que polluer ou tricher coûte beaucoup, beaucoup plus cher que payer. Avec une publicité conséquente ? Une interdiction d’exercer ? Une saisie sur fonds propres ? Une blacklist déposée à la SACD ? Une juridiction mieux dédiée, mieux formée que l’existante ?
– repenser la feuille de droits ?
– avoir notre MBA (enfin !) Non, pas le diplôme de manager (quoique), mais l’équivalent français du Minimum Basic Agrément, ou Agrément Basique Minimal qui soit opposable à tout contrat. Avec des rémunérations du brainstorming et des ateliers, et pour chaque étape des prix planchers, si si, puisque qu’actuellement, on voit le troisième sous-sol depuis le grenier.
– un pourcentage automatique sur TOUTE vente au premier euro collecté : les créateurs sont devenus, de fait, depuis des années les plus gros financiers de l’audiovisuel, par les millions d’heures de travail gratuit fournies sans compter ni rémunération.
– une fusion syndicat et SACD, notre société de perception ne distribuant pas les droits sur des contrats ne rentrant pas dans le MBA précité serait le meilleur bouclier pour que ses membres refusent de signer les ukases léonins devenus de fait aussi caduques qu’illégaux.
– une partition des répertoires et un cloisonnement permettant à chaque corporation créative de défendre ses intérêts propres autant que les intérêts communs lorsque l’unité est de mise.
– une variété de grades de rémunération salariée pour toute commande ou adaptation de format existant qui permette le partage des savoirs vers les plus jeunes en atelier.
– des durées d’exploitation et vente plus courtes et éphémères (30 ans, c’est beaucoup trop en ces temps d’accélération fulgurante de consommation et d’empilement croissant de contenus, 10 ou 15 suffiraient largement), des retours plus clairs aux créateurs à défaut d’exploitation, sans ces clauses scélérates qui rendent les auteurs responsables et redevables des dettes que leur producteur à grassement généré sur leur travail.
Voilà quelques pistes pour l’instant. Maladroites ? Alan Smithie volontiers. Indispensables ? Sans aucun doute.
Car notre business model n’est plus le même, plus le bon. Alors que les modes de production et de consommation changeaient, de vicié, il est devenu vicieux, fautif et pousse-au-crime. Il est plus qu’urgent de le repenser.
Qui a dit « grève » ?
M.D
PS : Sur le scénario Siritz.com a publié un Carrefour https://siritz.com/le-carrefour/evaluer-un-scenario-par-yves-lavandier/