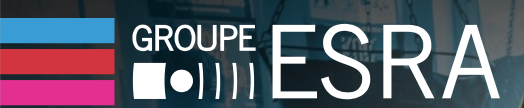Le directeur de production est le directeur des solutions
Thomas Santucci est le président de l’Association des directeurs de production. Il explique le rôle de ces collaborateurs essentiels des producteurs et les enjeux de leur métier. C’est aussi un poste stratégique pour analyser les défis que doit relever la production française.
Voir sa carrière :
http://www.directeurdeproduction.com/files/cvall/SANTUCCI_Thomas_cv.pdf
Siritz : Comment définiriez-vous le rôle du directeur de production ?
Thomas Santucci : C’est un peu comme le Premier ministre dans la Vème République. Le producteur étant le Président de la République. Il mène la politique de fabrication du film en fonction de deux lignes directrices, qui sont parfois contradictoires, D’une part, celle du financement réuni par le producteur. Et, d’autre part, celle de l’ambition artistique du réalisateur, qui a peut-être travaillé sur le scénario pendant des années. Son rôle est donc de faire coïncider ces deux lignes. Mon père en cinéma, Patrick Grandperret, qui était à la fois réalisateur et producteur, disait qu’un directeur de production devait être un directeur des solutions. Pour tous ceux qui collaborent au film, réalisateur, techniciens ou prestataires, c’est celui qui est là pour rendre les choses possibles, dans des conditions économiques données, qui sont parfois restreintes.
Siritz : Comment devient-on directeur de production ? Vous avez fait HEC. J’imagine qu’il y a de nombreuses formations possibles. Mais ce que vous venez de décrire suppose de connaître tous les aspects de la fabrication d’un film. Comment démarrer ?
Sylvie Pialat m’a fait rencontrer Patrick Grandperret
TS : Il y a des parcours divers. Mais on peut dire que la plupart des directeurs de production français viennent de l’un des deux corps d’encadrement que sont la régie ou la mise en scène. Et puis, il y a les cas particuliers, dont je fais partie. Pendant HEC et après j’ai été apprenti journaliste. Puis je suis passé par la filière du court-métrage. C’est un véritable laboratoire d’expérience pour tous les postes. Les enjeux économiques sont moins importants que pour un long métrage. Ce qui permet à des jeunes de s’aguerrir dans un poste auquel ils n’auraient pas accès dans l’économie du long métrage. J’ai donc appris sur le terrain. Et puis, après, il y a les rencontres fortuites.
Il y a 15 ans j’ai rencontré Sylvie Pialat, qui avait monté Les films du Worso. Elle m’a fait rencontrer Patrick Grandperret. Je suis devenu directeur de production sur ses derniers longs métrages, dont « Meurtrières » sorti en 2006. C’était un des premiers rôles de Céline Sallette. J’ai par la suite eu la chance de partager des expériences très fortes avec des réalisateurs pour qui j’ai la plus grande admiration, comme Alain Guiraudie, Patricia Mazuy ou Mikhaël Hers. Ils m’ont permis de grandir dans la pratique de ce métier.
Siritz : Donc votre parcours est un peu différent de la majorité de vos collègues ?
TS : Oui. En général, ils avaient une expérience plus avérée quand ils ont accédé à la direction de production. Moi, j’ai appris en faisant. Je suis en préparation de mon vingtième long métrage comme directeur de production, et j’ai toujours l’impression d’apprendre.
Faire intervenir le directeur de production pendant la phase de développement
Siritz : Quel est ce film en préparation ?
TS : Il s’appelle « Compagnons ». Il est produit par Soyouz Films. Et il est écrit et réalisé par François Favrat. C’est notre première collaboration.
Siritz : À quel stade intervient le directeur de production ?
TS : Il y a plusieurs cas. Ce qui me paraît pertinent, c’est de le faire intervenir pendant la phase de développement, et avant même le montage financier, pour définir le périmètre de fabrication. Le producteur a plus ou moins une idée des financements qu’il peut trouver. D’ailleurs, aujourd’hui, en général, les producteurs sont plus compétents sur le financement qu’experts de la fabrication, dont ils sont très rarement issus. Le directeur de production discute avec le réalisateur et le ou les scénaristes, pour leur proposer des choses faisables, correspondant au financement dont le producteur estime qu’il disposera. Il m’arrive d’intervenir deux ou trois ans avant la mise en production du film. Je fais alors une première estimation et des suggestions. Mais mon rôle commence vraiment 5 ou 6 mois avant la fabrication, quant on commence à entamer les repérages. A ce moment là, à priori, le financement est connu.
Siritz : Dans le coût d’un film il y a un poste très important c’est le casting des premiers rôles. Est-ce que vous intervenez ?
TS : Non, je n’ai pas voix au chapitre. Et c’est normal, car c’est vraiment l’endroit du réalisateur et des producteurs. Et le financement dépend en grande partie du casting. Les comédiens ont une certaine valeur de marché, estimée par les producteurs, les investisseurs et les agents. Et ils ne sont pas substituables si facilement les uns aux autres. Bien entendu il y a une part de négociation. Mais, pour faire baisser les coûts de productions, pas plus que nos Premiers ministres les directeurs de production ne sont des magiciens. En fait, pour réduire les coûts, on peut jouer sur certaines scènes, en mettant moins de figurants, en arbitrant entre le studio et le décor naturel. Mais il n’y a pas de secret : les solutions se trouvent essentiellement dans le scénario, et il faut donc établir un rapport de confiance mutuelle fort avec le réalisateur.
Culturellement le cinéma français se tourne en décor naturel
Siritz : Quand j’ai mené mon étude sur la crise des studios français, il m’est apparu qu’une des causes de cette crise, c’était que les réalisateurs français avaient tendance à privilégier le tournage en décor naturel et à ne tourner en studio que s’ils ne pouvaient faire autrement. Or c’est l’opposé de la tendance des réalisateurs étrangers, et notamment des anglo-saxons. C’est presqu’une position idéologique, depuis la Nouvelle Vague. Avez-vous la même analyse ?
TS : Effectivement, le cinéma français, culturellement, depuis la Nouvelle Vague, est un cinéma qui se tourne en décor naturel. Cela vient, pour la majorité des réalisateurs français, de leur formation et de leur culture. Pour les anglo-saxons, c’est l’opposé, mais pas de manière aussi nette. Beaucoup d’entre eux tournent aussi en décor naturel. Sur les films français il y a des cas de figure où les directeurs de production, les directeurs de la photo, les chefs décorateur et, même, les assistants réalisateurs savent que c’est plus judicieux de tourner en studio. Mais il faut en discuter avec le réalisateur : la solution technique et/ou ou financière n’est la bonne que si le metteur en scène s’en empare pleinement.
Siritz : Est-ce qu’il y a des cas typiques ?
TS : Oui. Par exemple, le tournage dans un appartement parisien. Au bout de 6 jours de tournage, avec des gens qu’il faut reloger, des camions à garer dans la rue, des voisins avec qui cohabiter, etc, cela devient plus intéressant de tourner en studio. Et puis quand, dans les décors, il faut faire des cascades ou des effets spéciaux le studio est plus commode. Mais il faut discuter avec les réalisateurs, car beaucoup d’entre eux sont mal à l’aise à priori dans le tournage en studio.
Les réalisateurs de téléfilms sont plus techniciens que les réalisateurs de cinéma
Siritz : Est-ce que c’est différent avec les réalisateurs de fictions tv ? Dans les séries, où l’un des intérêts financier est d’utiliser des décors récurrents, c’est évident.
TS : J’ai travaillé sur quelques téléfilms. La première différence c’est qu’ils reposent sur une économie plus réduite pour les producteurs. Et, donc, plus normée en fabrication. Ce qui n’a rien à voir avec la qualité. C’est l’opposé des films de cinéma qui sont des prototypes, réputés non reproductibles. Mais un téléfilm c’est 20 et 24 jours de tournage, alors que les longs-métrages de cinéma se tournent rarement en moins de 30/35 jours. Et puis, mon expérience c’est que les réalisateurs de téléfilms sont souvent plus techniciens que les réalisateurs de cinéma. Ils connaissent les conditions financières et, donc, les conditions techniques permettant de les respecter. Quoiqu’avec Grandperret ou Guiraudie, j’ai travaillé avec des réalisateurs qui avaient une très forte conscience des aspects techniques et financiers. Ce n’est donc pas une règle absolue.
Siritz : Mais, de plus en plus de producteurs de cinéma font des séries. De même pour les réalisateurs de cinéma qui tournent des épisodes de série. Est-ce que cela ne va pas modifier leur approche de la fabrication des films ?
TS : Si. J’en suis persuadé. Cela nourrit leur réflexion. Par exemple, Rebecca Zlotowski a tourné la remarquable série « Les Sauvages », avec Roschdy Zem, diffusée sur Canal+. J’ai la sensation que cela a nourri son expérience et lui servira pour ses prochains films de cinéma. De même, pour « Le bureau des légendes », Eric Rochant, lui-même grand réalisateur de cinéma, a plutôt fait appel à des réalisateurs identifiés comme réalisateurs de cinéma. Je suis sûr que cela va avoir un impact sur leur cinéma.
Le modèle économique du cinéma français est en train de mourir à petit feu
Siritz : Ces passerelles vont être d’autant plus nécessaires que le modèle économique du cinéma français doit évoluer. https://siritz.com/editorial/production-cinema-les-limites-du-systeme/
TS : Evidemment. Ce modèle économique, reposant notamment sur le financement de Canal+ et des chaînes, est en train de mourir à petit feu. Et la crise actuelle va accélérer ce processus.
Siritz : Mais le cinéma français a toujours été en crise.
TS : C’est vrai. Même quand j’y suis entré, il y a presque 20 ans, il vivait dans la fin de la période dorée des années 80/90 et on parlait déjà de sa crise. Mais, aujourd’hui, je crois que cela correspond de plus en plus à une réalité. La raréfaction des sources de financement va forcément nous obliger à revoir nos méthodes de fabrication. D’autant plus que l’on a vu émerger à la télévision des œuvres de très grande qualité, comme « Le bureau des légendes », « les Revenants », « Zone Blanche ». Et il y en a d’autres, sur Canal+, Arte ou les autres grandes chaînes. Elles ont été fabriquées dans une économie plus contrainte qui n’a pas nui à leur qualité.
Siritz : Quel impact vont avoir les mesures sanitaires à respecter pendant les tournages ?
TS : En mai notre association de directeurs de production a contribué, comme toutes les associations de techniciens, à l’élaboration du guide des précautions à prendre pendant les tournages. En juin on se rend compte que la situation est extrêmement évolutive. Au point que certaines préconisations faites il y a quelques semaines peuvent être soupçonnées d’être obsolètes. C’est difficile d’être dans la juste mesure. Ce qui est sûr, c’est que notre responsabilité collective est très grande.
Siritz : Dans Le Carrefour de Remy Chevrin il insistait sur le fait que ces mesures étaient des suggestions, mais pas des obligations et que, ceux qui venaient sur un tournage n’étaient pas obligés de les suivre. Par exemple, prendre sa température en arrivant.
TS : C’est le droit français. Le chef d’entreprise ne peut subordonner un emploi à une clause de bonne santé. Les tests, par exemple, se font sur la base du volontariat. De toute façon on marche en terrain inconnu. On pense que le gros de l’épidémie est passé. Mais on ne peut faire comme si rien ne s’était passé. On a eu des scénarios d’effondrement de la filière cinéma en France. Je ne suis pas certains qu’ils soient totalement écartés. Les prestataires souffrent énormément de l’arrêt de l’activité et de sa reprise graduelle. Les producteurs souffrent énormément, tout comme les distributeurs et les exploitants. Il est probable que cette situation va accélérer les évolutions qui étaient en œuvre, notamment du modèle économique.
La situation sanitaire évolue vite
Siritz : Parmi les problèmes il y a le problème de l’assurance contre les risques de pandémie. Le premier fonds qui a été mis en place limite les remboursement à 20%, avec un plafonds de 1,2 millions €. Cela me paraissait dérisoire pour un film de budget un peu conséquent. Aujourd’hui plusieurs mutuelles ont alimenté un fonds d’un millions €, le remboursement est de 30% et le plafond de 1,8 millions €. Qu’en pensez-vous, vous et vos collègues ?
TS : La situation évolue très vite. Il y a encore quelques semaines aucun producteur ne voulait lancer un tournage. Le risque était trop grand à prendre. Aujourd’hui, j’ai l’impression que ça évolue. Depuis deux ou trois semaines les producteurs appellent les directeurs de production. Moi, je reçois plusieurs appels par semaine, pour des tournages à la fin de l’automne. C’était inenvisageable il y a peu. Mais il faut rester très prudent, ce qui est paradoxal : lancer un processus de fabrication nécessite un enthousiasme formidable, un élan qui peut être brutalement remis en cause par l’évolution de la situation sanitaire.
Siritz : Mais concrètement est-ce que les mécanismes d’assurance semblent satisfaisants ?
Les compagnies d’assurance doivent se mouiller
TS : Il y a un film pour lequel un producteur m’a appelé. Effectivement, il ne voit pas encore clair du point de vue de l’assurance. Il est nécessaire d’aller jusque dans les détails. Je pense qu’on aura une plus grande visibilité en septembre ou octobre. Or, naturellement, tout le monde a en tête cette éventuelle deuxième vague de l’épidémie. Les assureurs défendent leur point de vue, qui est très malthusien par rapport aux risques et aux efforts de l’ensemble de la filière. Les courtiers et le CNC font un gros boulot pour monter une protection qui marche. Mais je pense que les compagnies d’assurance doivent se mouiller. On a l’impression que les assureurs veulent qu’on paye les assurances, mais, à condition qu’on n’ait jamais recours à eux. La crise concerne le cœur de leur activité, qui, semble-t-il, sur le long terme, est rentable. Or, ils se tournent vers la puissance publique pour prendre leur place et trainent les pieds pour faire le moindre effort.
Siritz : Mais peut-être que les assureurs vont trouver que la production cinéma est trop risquée pour eux.
TS : C’est un risque, en effet. Et cela entrainerait l’effondrement de la filière en France. Peut-être que les gros opérateurs américains, notamment les GAFA comme Netflix, Amazon ou Apple, et peut-être les majors, qui appartiennent à de très grands groupes, auront le moyen de s’auto-assurer. Mais pas les producteurs français qui sont, presque tous, des indépendants. Et l’Etat ne pourra combler durablement la défaillance des opérateurs privés, en l’occurrence les compagnies d’assurance.
Or, je constate qu’en face, l’ensemble de la filière, des producteurs aux techniciens et comédiens, des exploitants aux prestataires, a fait preuve d’une grande résilience et, souvent, d’une certaine solidarité. Il serait effroyable que notre industrie, si riche et performante, meure du fait d’un défaut d’assurance. Pendant ce confinement très anxiogène, beaucoup se sont nourris de films, de séries, d’unitaires très divers. Il serait inimaginable que tout cela disparaisse.