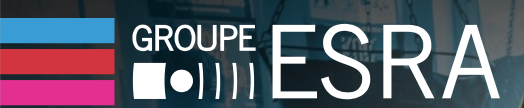Siritz.com : A qui s’adresse « Évaluer un scénario » ?
Yves Lavandier : En priorité aux professionnels qui sont censés évaluer un scénario (au sens de récit) : aux producteurs, aux consultants/scripts doctors, aux diffuseurs, aux membres des commissions, aux éditeurs de bande dessinée. En fait à tous les décideurs, à tous ceux qui se prononcent sur la lecture d’un scénario. Et puis aussi aux auteurs qui cherchent une grille de relecture de leur propre projet. Le chapitre 6 leur est spécifiquement destiné.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Lavandier
Siritz.com : En France, on estime que l’auteur d’un film est essentiellement le réalisateur et que c’est lui qui doit écrire le scénario, même s’il peut se faire aider par d’autres. C’est l’inverse des pays anglo-saxons, notamment des États-Unis, où, sauf exception, tout part du scénario et où le réalisateur intervient après. Je crois que, chez nous, cela date de la Nouvelle Vague. Est-ce que c’est en train d’évoluer ?
YL : Oui. Un petit peu. Pas assez à mon goût, mais il faut être honnête, ça évolue. Il y a un cas célèbre, post-Nouvelle Vague, qui a montré la voie, c’est « Ridicule », sorti en 1996. Le scénario a été écrit par Rémi Waterhouse (avec la collaboration de Michel Fessler et Eric Vicaut) et le film réalisé par Patrice Leconte. Ce dernier a eu l’honnêteté de ne pas mettre son nom au générique comme coscénariste et de se considérer uniquement réalisateur. A l’époque, c’était une exception spectaculaire. Aujourd’hui, on commence à comprendre que c’est non seulement un type de création possible mais que cela peut mener à une œuvre d’art, comme en leur temps « Douze hommes en colère », « Miracle en Alabama » ou « Amadeus ». Ou même, chez nous en 1945, « Les enfants du paradis », avant les excès de la Nouvelle Vague.
Notre loi stipule qu’un film a plusieurs auteurs
Siritz.com : Donc la tradition évolue.
YL : Oui. Notez que cette tradition, en fait, ne date pas de la Nouvelle Vague. Elle prend racine dans les années 1920. Quand Germaine Dulac, Élie Faure, Ricciotto Canudo et d’autres ont décrété, à raison d’ailleurs, que le cinéma était un art. Et qu’en plus, à ce titre, il ne pouvait y avoir qu’un seul artiste. Car, si l’art est dilué dans la collaboration, cela cesse d’être glorieux. Non seulement cette fierté est ridicule mais elle est aussi illégale en France. Notre code de la propriété intellectuelle, qui date de 1957 (légèrement révisé en 1992) stipule très clairement qu’un film, comme une œuvre audiovisuelle, ont plusieurs auteurs. On trouve même dans la loi trois mots qui donnent des pustules aux idéologues de la politique des auteurs : « réalisée en collaboration ». Ce n’est pas « créée en collaboration » ou « conçue en collaboration », non c’est « réalisée ». C’est tellement insupportable que, dans un traité récent, un défenseur ardent de la politique des auteurs cite le texte de la loi mais en omettant ces trois mots !
Siritz.com : En France, comme dans le monde entier il y a aussi une évolution très importante, c’est le développement des séries, et certaines d’entre elles sont incontestablement des œuvres d’art. Or, pour une série, le scénario est essentiel. Au point qu’il y a souvent plusieurs réalisateurs qui se partagent les épisodes. Et, très souvent aussi, il y a plusieurs scénaristes dirigés par un showrunner, une sorte de scénariste-en-chef. Vous ne pensez pas que cela va avoir une influence sur le cinéma ?
L’impact du succès et de la qualité des séries
YL : C’est le deuxième élément, après « Ridicule », qui nous laisse à penser que l’on va enfin cesser de nier le réel. Car, affirmer que le réalisateur est le seul auteur d’un film c’est nier le réel. La claque est arrivée à la fin des années 90 avec « Friends », « Urgences » et « Ally McBeal » en prime-time. C’était la première fois que des séries américaines avaient l’honneur du prime-time. A partir de là, les Scuds n’ont pas cessé : « Les Soprano », « South Park », « Breaking bad », etc… On a compris que pour arriver à cette qualité, les Anglo-Saxons ne mettent pas uniquement le scénario mais aussi le scénariste au centre du dispositif. Ce qui implique de traiter le scénariste correctement, donc de changer les mauvaises habitudes du cinéma et de l’audiovisuel français.
Siritz.com : Donc, ça doit avoir un effet énorme en France. D’autant plus qu’il y a des séries françaises de très haut niveau comme « Le bureau des légendes » ou « Un village français ». https://siritz.com/le-carrefour/the-making-of-le-bureau-des-legendes/
YL : Quelques unes, en effet, dans lesquelles, justement, le scénariste principal est respecté. Cela dit, il y a encore beaucoup de cinéastes qui ont un très grand mépris pour tout ce qui touche à la télévision. Certains vont jusqu’à refuser de regarder des séries. Ils doivent avoir en tête cette phrase de Godard : « Quand on va au cinéma, on lève la tête ; quand on regarde la télévision, on la baisse ». Le mot est joli. Mais j’ai envie de dire à Godard : « Prenez un écran16/9 haute définition, mettez-le sur votre réfrigérateur et vous lèverez la tête ». Je pourrais aussi suggérer à Godard de regarder « Sur écoute ». C’est une œuvre d’art, avec un point de vue sur le monde, dont l’auteur principal est scénariste et se nomme David Simon. Mais bon, nul doute que la qualité des séries commence à travailler l’inconscient culturel en France, y compris celui du cinéma.
Siritz.com : Est-ce que vous êtes intervenu comme script doctor de séries ?
YL : Très peu. J’ai surtout travaillé sur des films de cinéma, court ou long, et un peu de théâtre. Cela dit, la tâche est la même. Les grands principes de la narration s’appliquent autant aux unitaires qu’aux séries. C’est juste l’échelle qui change.
Les trois étapes de l’évaluation
Siritz.com : Pour l’évaluation du scénario, vous vous servez d’une métaphore médicale afin d’identifier trois étapes : le symptôme, le diagnostic et la prescription.
YL : Oui, trois positions dont la distinction est absolument nécessaire quand on reçoit une œuvre d’art. D’ailleurs, elle peut très bien s’appliquer à d’autres domaines que le cinéma. La musique, la peinture, la gastronomie… Le symptôme représente le ressenti personnel du récepteur. Il s’exprime forcément dans une phrase qui commencer par « Je ». Je ne comprends pas, je ris, je m’ennuie, je tourne les pages, je suis surpris… Le gros intérêt du symptôme, c’est qu’il est indiscutable. Si un consultant ou un spectateur dit à un auteur « Je me suis ennuyé », l’auteur ne peut pas répondre : « Mais non, vous ne vous êtes pas ennuyé ! ».
Siritz.com : Puis il y a le diagnostic.
YL : C’est l’explication technique du symptôme. Par exemple, si je m’ennuie cela peut être dû au fait qu’il n’y a pas assez de conflit dynamique, ou pas d’enjeu, ou pas de protagoniste clairement identifié, etc… Une fois qu’on a fait le diagnostic, on peut passer aux prescriptions. C’est-à-dire expliquer aux auteurs ou au producteur ce qu’à notre avis, il faudrait faire pour améliorer le récit : mettre un incident déclencheur, raccourcir le troisième acte, intervertir protagoniste et antagoniste, exploiter une information en ironie dramatique plutôt qu’en mystère, etc. Au-delà de ces généralités, la prescription peut aller jusqu’à fournir des idées concrètes et spécifiques, adaptées au projet. Cela devient une forme de réécriture.
Siritz.com : Vous dîtes que la prescription doit fournir la piste, mais que c’est à l’auteur de la mettre en œuvre.
YL : Oui. D’abord parce que ce n’est pas le travail du consultant d’écrire à la place des auteurs. Ensuite, parce que les prescriptions peuvent être à côté de la plaque. Sur ce point il y a une expérience fascinante. Si vous allez dans un atelier de réécriture, comme on en trouve à Sundance ou à Plume & Pellicule, vous êtes souvent lu par une demi-douzaine de consultants. Systématiquement, vous constaterez qu’ils s’accordent sur le symptôme, un peu moins sur le diagnostic et très rarement sur les prescriptions. Pourquoi s’accordent-ils sur le symptôme ? Parce que le ressenti, même s’il est personnel, n’est pas uniquement subjectif. Une partie du ressenti est objective. On reçoit une œuvre d’art avec des critères qui sont universels, intemporels et communs à tous, en même temps que des critères personnels qui dépendent de notre éducation, de nos goûts et de nos névroses. Donc, sans s’en rendre compte, on mélange ressenti objectif et ressenti subjectif.
Siritz.com : C’est pourquoi tous s’accordent plus ou moins sur le symptôme. Mais le diagnostic ?
YL : S’ils sont tous pros, à partir du même texte et du même symptôme, ils vont faire le même diagnostic. Prescrire, c’est autre chose, c’est commencer à réécrire. Or les gens réécrivent en fonction de leur inconscient et de leur point de vue sur le monde. Quand on réécrit, on met du sens. Et celui du consultant n’est pas forcément celui de l’auteur. Donc les prescriptions doivent donner de grandes lignes, mais c’est à l’auteur de réécrire, quand il a compris quel est le problème et dans quelle direction chercher.
Les prescriptions ne doivent pas réécrire
Siritz.com : Et, de votre expérience, ces trois phases sont différenciées par les producteurs, consultants, diffuseurs ou comédiens ?
YL : Par les consultants professionnels, majoritairement oui. Mais pas du tout par les décideurs. Le travers classique et récurrent consiste même à entrer tout de suite dans la prescription sans passer par le symptôme. Ils vont dire à l’auteur, de but en blanc : « Pourquoi tu ne démarrerais pas après l’accident ? », « Et si la protagoniste était plutôt informaticienne ? », « Le café devrait être empoisonné »… Cela ne sert jamais à rien à l’auteur. Jamais ! L’auteur comprend que son lecteur a eu un problème, mais qu’il n’a pas été capable de l’identifier, encore moins de le diagnostiquer et qu’il est passé directement à la réécriture à la place de l’auteur. Dans ces cas-là, quand je suis scénariste (car je fais beaucoup appel à des script doctors pour mes propres projets), je demande systématiquement au lecteur de commencer par me parler de son symptôme. Pour la solution, je verrai plus tard.
Un auteur a besoin que l’on apporte de l’eau à son moulin
Siritz.com : Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon consultant ?
YL : Il y en a beaucoup. D’abord, la bienveillance et l’humilité. Un consultant n’est pas là pour avoir raison ou pour imposer ses goûts personnels mais pour aider l’auteur à améliorer son récit et à transmettre sa pensée. Ensuite, la positivité. Que l’on soit consultant ou décideur, quand on a l’auteur en face de soi, on doit commencer par la partie pleine du verre. J’ai une formule à ce sujet : « Avant qu’on lui donne du grain à moudre, un auteur a besoin qu’on apporte de l’eau à son moulin. » Ce n’est pas une question d’ego à satisfaire. C’est une question d’énergie à entretenir. Malheureusement, cela donne l’air tellement plus intelligent de critiquer que de faire des compliments. L’authenticité, aussi, est importante. C’est même une valeur cardinale. Si vous lisez un scénario avec des a priori, une posture, en attendant l’auteur au tournant (que ce soit en bien ou en mal), vous ne lisez pas correctement. Vous êtes même le plus mal placé pour donner un avis.
Siritz.com : Votre livre a eu deux éditions successives après la première en 2011. C’est sans doute à partir de votre expérience de consultant que vous avez rajouté des éléments.
YL : Oui, bien sûr. Mon expérience professionnelle nourrit mes livres. Dans la première édition de 2011, j’ai développé une des annexes de « La dramaturgie » qui s’appelait « Lire une pièce ou un scénario » et qui occupait 5 pages. Cela faisait plusieurs années que je voyais à quel point l’évaluation du scénario est handicapée en France. D’ailleurs, nous avons déjà eu l’occasion d’en parler à la fin des années 90, quand j’écrivais des articles dans Écran Total. Vous m’aviez dit une phrase très juste, dont je me souviens encore : « Le scénario, c’est le goulot d’étranglement du cinéma ». Curieusement, ce sujet n’est traité par personne, même en anglais. J’ai donc développé mon petit chapitre et suis passé de 5 à 100 pages, au fil des rééditions.
Siritz.com : Est-ce qu’il y a des défauts courants dans les scénarios qu’on vous confie ?
YL : Oui. Les humains doivent avoir tendance à faire les mêmes erreurs. Je me compte volontiers dans le tas, quand je porte ma casquette de scénariste. C’est tellement difficile de réussir une création aussi riche et exigeante qu’un récit. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de lire des scénarios pour s’en rendre compte, il suffit d’aller au cinéma. Ou de lire des romans. Parmi les défauts les plus courants : manque de clarté et manque de conflit dynamique. Trop de sujets d’identification possibles. Point de vue pas développé ou pas assumé. Absence de résolution. Manque de structure. Pas d’enjeu. Ce dernier point est tragique, car il est très difficile de s’identifier quand il n’y a pas d’enjeu. Dans « Évaluer un scénario », je liste et détaille une douzaine de travers récurrents.