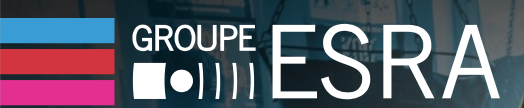CINÉMA : UN MODÈLE D’INDUSTRIALISATION RÉUSSIE
Par Serge Siritzky
Il y a un rare domaine où l’industrie française a beaucoup mieux resisté que n’importe quel autre pays européen à la domination de l’industrie américaine, c’est le cinéma : un modèle d’industrialisation réussie. Compte tenu que la désindustrialisation de la France est à la fois l’une des caractéristiques et l’une des princIpales causes de son désastre économique et financier, nos gouvernants auraient intérêt à rechercher les facteurs de la réussite de ce secteur et à s’en inspirer pour élaborer une politique économique performante.
Le principal outil de cette réussite est le compte de soutien automatique qui s’analyse comme une épargne forcée obligeant les entreprises françaises de production, de distribution et d’exploitation à constamment investir pour en bénéficier. Investir c’est à dire aussi innover. La taxe additionnelle de 10,7% sur le chiffre d’affaires qui alimente ce soutien est également un droit de douane sur les productions étrangères, et, compte tenu de leur part de marché, avant tout américaines. Mais les entreprises étrangères peuvent bénéficier de ce soutien si elles s’installent en France et investissent dans des productions françaises. En tout cas ce droit de douane permet de redistribuer sous d’épargne forcée beaucoup plus que le produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises françaises.
Malheureusement, au fil des années, compte tenu des charges sociales, qui s’analysent comme une lourde taxe sur l’emploi en France , auxquelles s’ajoute, notre durée légale de travail qui amplifie le poids de cette taxe sur l’emploi, les producteurs de films ont eu de plus en plus de mal à fabriquer leurs films en France et ont délocalisé une part croissante de cette fabrication.
La France a alors décidé de faire bénéficier les tournages sur le territoires national d’un crédit d’impôt. Celui-ci s’analyse comme une subvention compensant cet alourdissement des coûts de fabrication. La délocalisation a été stoppée et la fabrication de films étrangers en France s’est développé. Bien plus, il est démontré que le montant de ces subventions, par l’activité sur le territoire français qu’elles génèrent, est surfinancé par les impôts supplémentaires payés par ce surcroît d’activité entrainé par le crédit d’impôt : la baisse de prélèvement public, en créant de la croissance, a été plus que compensée par l’augmentation des recettes publiques !
Le compte de soutien automatique a été étendu à la production d’œuvres dans l’industrie audiovisuelle. La taxe, qui n’est que de 5,5%, s’analyse comme un droit de douane non seulement sur les œuvres étrangères mais aussi sur toutes les émissions de flux, qui constituent la majorité des programmes des chaînes de télévision. En outre la fabrication d’œuvres audiovisuelles sur le territoire nationale bénéficie elle aussi du crédit d’impôt. Là encore, il n’est pas étonnant que ce soit des entreprises françaises qui sont les plus gros producteurs audiovisuels européens.
Enfin l’État ne s’est pas contenté de mettre en place ces mécanismes géniaux. Il a mis en place une véritable politique industrielle, incitant des entreprises françaises à être à la pointe des technologies de fabrication des œuvres. En effet, dans son Plan pour la ré-industrialisation de la France d’ici 2030, il a prévu de soutenir financièrement les entreprises privées qui investiraient dans de grands et modernes studios de tournage, indispensables pour fabriquer, en utilisant les techniques les plus performantes, tous les films et les séries répondant aux besoins d’un marché toujours plus exigeant. Et la France est en train d’avoir, sur l’ensemble du territoire, un véritable réseaux de ces studios.
Pourquoi ces deux mesures et cette stratégie industrielle, qui ont si bien réussi pour notre cinéma et nos œuvres audiovisuelles, ne seraient-elles pas appliquées à l’ensemble des industries françaises ?