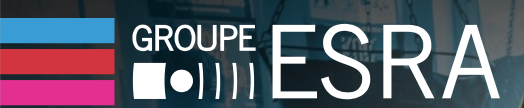Siritz : Vous avez remis en 2014 un rapport sur le financement de la production et de la distribution française à l’heure du numérique. Quelles étaient les réformes essentielles que vous préconisiez ?
René Bonnell: Je voudrais dire au préalable que j’ai eu de la chance que le CNC ait appliqué une majorité de mes préconisations.
Siritz : Qu’est-ce qui a été retenu ?
RB : Tout d’abord, il a été mis un peu d’ordre dans le coût des films.
Siritz : En plafonnant à un million d’euros la rémunération d’un talent ?
RB : Cela ne figure pas dans mon rapport contrairement à ce que j’ai pu entendre. Cette mesure est purement cosmétique. Pour arrêter la dérive inflationniste des budgets de production, j’avais émis des propositions plus structurelles qui n’ont pas été retenues. Il reste que, désormais, le talent ne peut coûter plus d’un certain pourcentage du budget qui décroit avec le niveau de ce dernier.
Un bilan régulier
Par ailleurs, on a consolidé la situation financière des sociétés de production, en élevant le capital social minimum à 45 000 € (J’avais proposé 50 000 €), dont 25 000€ au minimum en numéraire totalement libéré. Cela reste insuffisant, car, quand on doit financer des films de plusieurs centaines de milliers voire de millions d’euros, on devrait pouvoir disposer de davantage de fonds propres. Les mécanismes d’encouragement fiscal existant devraient être mis davantage à profit pour attirer des capitaux extérieurs dans la branche.
Siritz : Vous avez également proposé des mesures pour consolider les films dits du milieu, ceux dont le budget se situe aux alentours de 4 à 6 millions €.
RB : Oui. En revoyant la répartition de l’aide automatique à la production et à la distribution. Ce qui a été fait.
Ne pas dépasser un ratio de 50% d’aides sélectives
Siritz : Est-ce qu’il y a des réformes que vous jugiez essentielles n’ont pas été mises en œuvre ?
RB : Oui. D’abord la chronologie des médias. L’accord de l’année dernière est déjà obsolète. La profession devrait procéder à des reformes qui répondent à la réalité de la « consommation » cinématographique en sanctuarisant les salles avec une fenêtre de quatre mois.
Par ailleurs, j’avais proposé de faire un bilan régulier des soutiens accordés, pour éviter l’empilement actuellement constaté des aides créées en fonction de la dernière pression subie. Il s’agirait de ne pas dépasser en valeur un ratio de 50% d’aides sélectives, façon de limiter le saupoudrage actuel. La stimulation constante de l’offre comme cela s’est pratiqué depuis des décennies aboutit à une évidente surproduction qui s’accompagne souvent d’une certaine frustration des professionnels qui assistent au naufrage de leurs films en salles. Les statistiques à cet égard sont effarantes. On peut affirmer que la probabilité qu’un film échoue en salles est de l’ordre de 80 à 90%.
J’ai cherché à freiner la dissémination des structures de production et de distribution par une incitation au regroupement, en jouant sur la bonification des aides cumulées. On le sait, l’éparpillement des entreprises génère un cercle vicieux : fragile en trésorerie, le producteur consacre beaucoup de temps à faire le tour de toutes les aides possibles en France et en Europe. La demande de l’accroissement des aides sélectives est permanente et une telle politique est sans issue. Il faut régler le problème à la base, en poussant à la concentration et la diversification vers la télévision des entreprises de production.
Rappelons qu’une bonne moitié de la production française non préfinancée par une chaîne n’est vue au total que par un petit nombre de spectateurs. Dans la majorité des cas, elle ne connaît qu’une sortie confidentielle en vidéo ou souvent aucune diffusion sur les plateformes et ne sera pas exportée. Beaucoup d’énergie et d’enthousiasme pour très peu de résultats. C’est triste.
Que des films soient bénéficiaires avant de sortir n’est pas normal
Serge Siritz : Avec le recul de cinq ans quels résultat sur le coût des films ?
RB : Globalement, certaines dérives se sont arrêtées. Est-ce à cause de la mise en œuvre des mesures que je préconisais ou de l’essoufflement du fonds de soutien ? Est-ce à cause du niveau de plus en plus pléthorique de films distribués face à une fréquentation tournant autour de 200 à 210 millions d’entrées et incapable de les absorber ? Les deux je pense.
Mais si le coût des films a baissé, la cassure entre les films bien financés et les autres, à budget plus modeste, s’est aggravée. Il fallait mettre fin à certaines dérives inflationnistes en matière de budget. Mais il faut prendre garde de ne pas laisser vivoter une part de plus en plus importante de la production, source, bien souvent, du renouvellement des talents. A cet égard que des films soient bénéficiaires avant de sortir, cela n’est pas normal.
Siritz : Il y en avait beaucoup dans ce cas ?
RB : A l’époque du rapport, un film sur cinq environ. Et cela grâce à un usage habile des techniques de préfinancement et du vedettariat. Ce pourcentage a dû baisser. On jouait alors au social-démocrate pour appeler à un système de soutien financier d’aide publique et d’obligations d’investissement. Mais l’on devenait Tatchérien quand il s’agissait de jouer à l’offre et à la demande, notamment sur les cachets des auteurs et des interprètes connus. Il ne s’agissait que d’une poignée de talents dont on présupposait le succès garanti au box-office, en oubliant qu’une majorité d’artistes, interprètes ou techniciens, vivent difficilement de leur métier. Il y avait là une iniquité de répartition.
Aucune talent ne fait nécessairement marcher un film
Rappelons qu’aucun talent (cinéastes ou interprètes), ne fait nécessairement marcher un film. Toutes les statistiques le prouvent. Un succès transforme un acteur ou une actrice, voire un réalisateur en vedette qui, ensuite, va renouveler ou non son exploit. Mais, ce qui n’est pas renouvelé ce sont les cachets. Dans le marché américain, véritablement libéral, si un talent subit un ou deux échecs, son cachet s’effondre. Ce n’est pas le cas en France. On dit : un tel ou une telle on ne peut le payer moins de tant. Et pourquoi ? Parce qu’il en a toujours été ainsi. Peu importe le destin économique de l’œuvre. Mais sous l’effet de la crise du financement, les mentalités semblent évoluer.
Siritz : Vous avez fait des propositions sur l’exportation dont on dit constamment que c’est un marché et, donc, une source de financement que l’on pourrait développer.
RB : Oui. Elles ont abouti à la création d’une aide automatique calculée sur les entrées réalisées hors de nos frontières. Ce qui est plus efficace que l’aide sélective antérieure. A ce stade, il n’y a que deux ans de retour d’expérience et, avec le Covid 19, de nombreux marchés étrangers se sont effondrés. Mais le CNC veut poursuivre cette politique en l’adaptant pour éviter que lorsque les films de Luc Besson n’ont pas de succès ou ne sont pas sur le marché, le nombre d’entrées à l’étranger soit divisé par deux.
Il va manquer au moins 100 millions € au CNC
Siritz : Est-ce que 6 ans après ce rapport est toujours d’actualité ?
RB : Les premières lignes du rapport parlent d’affaissement du dispositif de soutien et, plus loin, de la raréfaction des ressources du fonds pour des raisons que j’explique. Alors que le CNC disposait à l’époque de réserves importantes. Cela lui permettait de maintenir le niveau du soutien par branche, mais masquait le lent tarissement de ses sources de financement. Cette appréciation n’était hélas pas erronée. Le CNC a dû faire des économies dès 2018. En 2020, avec le Covid 19, il va manquer selon moi au CNC au moins 100 millions €, en raison de la mise à l’arrêt durant trois mois des salles collectrices de TSA et de la contraction des recettes publicitaires des chaînes. Les ressources attendues des nouveaux contributeurs d’Internet et de la S-Vod mettront du temps à prendre le relais.
Siritz : Vous aviez demandé dans votre rapport que l’on fasse périodiquement un bilan de chacune des aides. J’ai d’ailleurs repris cette suggestion dans mon éditorial de la semaine dernière. C’est du bon sens, mais ça n’est toujours pas fait. https://siritz.com/editorial/pour-equilibrer-le-fonds-de-soutien/
RB : Oui. Chaque branche dispose de nombreuses aides. Et il faudrait que, régulièrement, on fasse un bilan, sans tabou, de chacune d’entre elles, pour les modifier ou les regrouper.
La fusion des obligations d’investissement des chaînes dans le cinéma et l’audiovisuel
Serge Siritz : D’autres reformes sont-elles nécessaires ?
RB : La grande réforme ce serait la fusion des obligations d’investissement des chaînes dans le cinéma et l’audiovisuel, avec un pourcentage minimum garanti à chacun des secteurs.
Siritz : Mais le cinéma est vent debout contre !
RB : C’est sûr. Une telle réforme aboutirait vraisemblablement à moins de films et plus de séries. Mais le total des obligations restant inchangées, le volume de commande et de travail dans le secteur audiovisuel resterait constant. Les chaînes pourraient faire des arbitrages, en concentrant des moyens sur des films à forte valeur ajoutée de production et à diriger certains films vers la télévision. A long terme, les cinéastes y gagneraient en faisant leurs armes sur le petit écran avant de passer au grand et de subir l’épreuve de plus en plus violente de la salle. Bien sûr, on pourrait demander aux chaînes de cofinancer un minimum de premières œuvres pour le cinéma.
Les grandes signatures du cinéma tournent désormais des séries
Siriz : Mais, une partie du cinéma a peut-être évolué. Car, de plus en plus de producteurs de cinéma produisent des séries et des réalisateurs de cinéma en réalisent. En outre, le niveau des séries s’est fortement élevé. Par ailleurs, c’est plus intéressant pour un réalisateur de tourner régulièrement des épisodes des séries que d’attendre plusieurs années pour faire son prochain film.
RB : Ce n’est pas un hasard si de grandes signatures du cinéma tournent désormais des séries. En prenant simplement l’exemple d’ARTE, une série touche de 800 000 à un million de spectateurs, voire davantage. Ce que peu de réalisateurs peuvent atteindre en salle. Il y a une époque où Daniel Toscan du Plantier, qui avait beaucoup d’esprit, disait, « la télévision c’est de la confection et le cinéma c’est de la haute couture ». Aujourd’hui ça n’est plus vrai. Et, on ne se déplace pour aller au cinéma que s’il y a quelque chose de très attractif et non sur des sujets largement traités à la télévision (policiers par exemple).
Passer des contrats de programme entre le CNC et des producteurs
Siritz : Revenons au problème des ressources du CNC.
RB : A court terme, le trou est tel que l’Etat va devoir intervenir, comme il l’a fait pour le fonds de garantie des tournages. On pourrait en profiter pour rechercher des effets structurels sur le secteur de la production. Par exemple, par la voie de contrats de programmes passés entre le CNC et les producteurs. On utiliserait les leviers des prêts de l’IFCIC et des aides à la production pour les exhorter à s’engager, à mettre en œuvre des premiers films, des films tournés vers l’exportation, d’investir en développement sur un temps long et à se diversifier en télévision.
Siritz : Ça tend à favoriser les grosses structures plutôt qu’un grand nombre de petits producteurs.
RB : Cela aurait surtout pour effet de renforcer les structures petites et moyennes. C’est nécessaire pour produire des films ou des œuvres audiovisuelles qui répondent avec plus de moyens à une demande réelle. Le nombre de jeunes allant au cinéma a été diminué par deux en 20 ans. Cela pose un problème que l’on ne peut ignorer.
Aller chercher l’argent là où il se trouve
Siritz : Dans l’économie du cinéma la principale source de financement de la production ce sont les chaînes gratuites. Inévitablement, indépendamment de la crise sanitaire, leur chiffre d’affaires va baisser. Les producteurs comptent sur les plates-formes de S-Vod pour compenser cette baisse. Mais celles-ci n’ont l’intention d’investir dans les films que marginalement. Dans ces conditions, qu’est-ce qui peut compenser la baisse de l’apport des chaînes.
RB : La question n’est pas simple. Ce qui est certain c’est qu’il faut aller chercher l’argent là où il se trouve. C’est-à-dire du côté des plates-formes qui, en tout cas, ne contribuent pas assez au fonds de soutien. Leur participation obligatoire annoncée au financement de la création peut devenir une source de financement de premier ordre.
Siritz : Mais si on aligne leur taxe sur celle de nos chaînes, elles vont demander d’aligner leur taux de TVA sur celui de Canal+ et de la passer de 20 à 10%.
RB : Peut-être. Cela ramène au fait qu’il faut optimiser les dépenses du fonds de soutien et affecter l’aide là où on en a besoin.
Siritz : Dans l’optique de l’équilibre des comptes du fonds de soutien vous avez parlé de la nécessité de faire un bilan régulier des aides sélectives
RB : C’est ce que j’avais proposé effectivement. Un bilan tous les deux ans et la répartition de 50/50 entre automatique et sélectif. Cela suppose des réformes stratégiques pour refondre le système. Il faudrait faire des choix douloureux, car il est plus facile de créer une aide que de réformer, regrouper ou supprimer les aides existantes. En économie du cinéma l’optimum est le maximum. Notamment en matière de création. Mais ce maximum est fixé par les ressources forcément limitées du système. Autant anticiper et éviter d’opérer une sélection par l’échec.
Pour attirer les capitaux privés il faut une réforme radicale des pratiques
Siritz : Une autre ressource ce sont les capitaux privés. Cela suppose évidemment qu’investir dans le cinéma soit une activité rentable.
RB : Je suis pour. Les capitaux privés ne s’engagent que parcimonieusement en production, car ils ne se récupèrent qu’à des seuils trop élevés de recette, derrière les frais d’édition, les éventuels à valoir et des priorités accordées aux producteurs délégués au niveau de l’aide. Les investisseurs extérieurs sont donc découragés. Mais il faut opérer une réforme radicale des pratiques en obéissant à plusieurs principes : intégrer les frais d’édition dans les budgets de production ; supprimer la technique du financement par à valoir qui a dévasté le secteur et correspondait à une époque où les résultats en salles étaient moins concentrés sur une poignée de films et ou plus d’argent remontait des salles sur davantage de films ; aligner les intérêts de tous les participants dans la récupération de leurs investissements.
Le distributeur se rémunèrerait par une commission qui couvre ses coûts de fonctionnement et demeurerait libre d’investir en coproduction. Toutes les recettes du film seraient ainsi partagées au prorata de l’investissement de chacun et amorties à la même hauteur. La part du producteur délégué tiendrait compte de son travail de développement, de ses frais généraux, de son apport financier et bien sûr de sa garantie de bonne fin. Certains films sont montés sur ces bases.
Siritz : En capitaux privés il y a déjà les Sofica. Malgré leur avantage fiscal leurs actionnaires ne gagnent pas beaucoup.
RB : On peut assouplir les règles, les faire intervenir davantage au capital. Mais, là encore, il faut que la remontée de recette soit plus rapide et plus équitable.
Ce miracle ne peut durer longtemps
Siritz : Comment est-ce que le système continue à fonctionner avec ces défauts ?
RB : A mon sens, sans réforme de fonds, ce miracle ne peut pas durer longtemps. Les pertes sont plus ou moins bien absorbées. Les circuits quand ils produisent ou distribuent s’en sortent avec les salles. Les distributeurs indépendants, avec un seul film bénéficiaire, peuvent amortir les pertes de plusieurs autres, mais beaucoup souffrent. Les diffuseurs télévisuels sur-financent souvent les œuvres en se disant qu’elles peuvent marcher sur leurs antennes. En cas de difficultés financières d’un opérateur, les fournisseurs ne sont pas payés, certaines avances ne sont pas remboursées. Cette collectivisation des pertes ne pourra pas constituer à terme une solution. Car chacun des partenaires du cinéma connaît aussi des problèmes qui pourraient affaiblir son apport financier au Septième art.
Voir la riche carrière de René Bonnell :